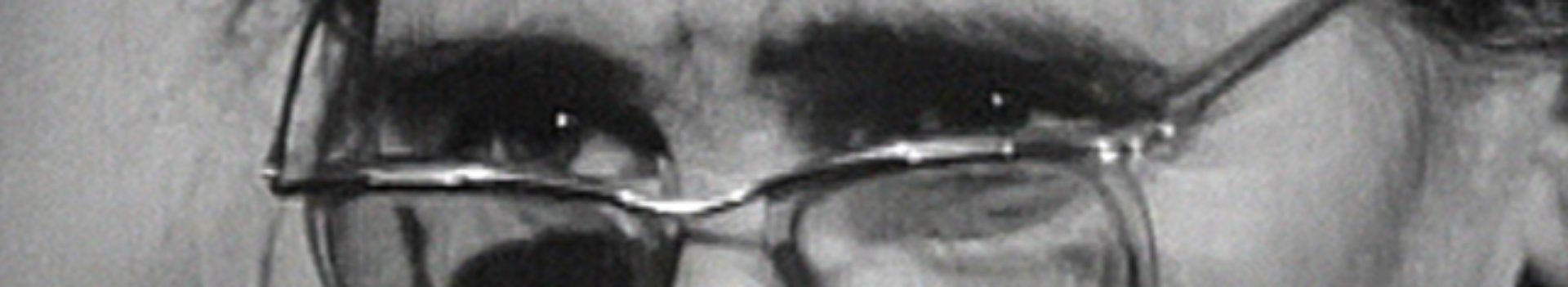Roger Laouenan
« Une demi-douzaine de poètes ne vaudront jamais un bon ouvrier agricole ! » s’écria un jour Anjela Duval, qui savait de quoi elle parlait, puisqu’elle cultivait la terre chaque jour avant de se mettre à écrire, le soir. Il y a bien plus qu’une boutade, dans ces mots de la dame de Traoñ-an-Dour. Elle avait capté les ondes du séisme installant un monde nouveau, radicalement différent de son enracinement dans le monde terrien, de son mode de vie présenté comme la somme d’une connaissance multiséculaire. Anjela Duval était profondément, et tout à la fois, bretonne, paysanne et poète. Elle ne voyait pas de passerelles possibles entre le monde ancien, le sien, et celui qui s’annonçait. Pourtant sa voix a franchi la frontière.
Seuls ses voisins, ses quelques amis, les membres de sa famille, le petit monde du Vieux-Marché, de Trégrom ont connu Anjcla Duval enfant, adolescente, jeune fille. Quand s’amorça, dans les années soixante, le « pèlerinage » de l’intelligentsia bretonnante vers Traoñ-an-Dour, la fermière, proche de ses soixante ans, offrait déjà l’image d’une femme marquée par une vie de durs labeurs. Sans concession à la plus petite coquetterie, elle apparaissait austère, sévère avec un bonnet recouvrant une chevelure à la diable, avec jupe et sarrau noirs. Elle allait d’un pas d’homme, sans grâce, en sabots.
Mais il y avait le visage. Le regard de velours sombre, celui de sa beauté juvénile, se posait sur vous, rasant la monture des lunettes (qu’elle ne portait que pour lire) et vous emprisonnait par une sorte de magnétisme. Lourd ou clair, incisif ou voilé de douceur, il disait l’intense vibration de l’intelligence, la sensibilité toujours sous-jacente, comme il menaçait de la colère sacrée.
Femme de grand air, elle préférait les travaux des champs aux besognes du ménage. Seul un bouquet de fleurs cueillies sur ses terres égayait la pièce principale, sombre en terre battue. La grande table de campagne avec ses deux bancs octroyait une place envahissante aux livres, journaux, lettres, à toutes sortes de papiers.
Peu amène avec des visiteurs désinvoltes, arrogants ou… sots, elle accueillait à bras ouverts la foule grossissante qui envahissait sa ferme. Anjela aimait le dialogue. Elle avait aussi une grande capacité d’écoute. Bien souvent de doctes débats s’instauraient à la grande table où crêpes, gâteaux, pain, beurre, café invitaient à la concélébration de la rencontre. Elle étonnait son auditoire par ses réparties fulgurantes, la sagesse de ses jugements.
Son rire clair et fort résonnait souvent quand elle se sentait en sympathie avec ses hôtes.
La langue bretonne primait sur le français, qu’elle utilisait cependant, avec une extraordinaire pureté, quand l’interlocuteur pouvait justifier son ignorance du breton.
On connaît sa boutade. Un visiteur dont l’accent trahit le Trégor entame la conversation en français. Anjela lui demande en breton : « Comment, vous ne savez pas le breton ? – Je le comprends mais je ne le parle pas », répond l’autre. « Alors, décoche Anjela, vous êtes comme mes chiens : eux aussi ils le comprennent mais ne le parlent pas. »
Elle ne quittait pratiquement jamais Traoñ-an-Dour. Personnellement, très surpris, je la vis une fois à Lannion où elle s’était rendue pour une visite médicale, et une deuxième fois quand lui fut décerné le prix Per Trepos. Très croyante, elle suivait la messe… à la radio. Pourquoi ce refus systématique de dépasser les limites de ses terres ? Elle invoquait des prétextes qui en réalité masquaient une raison intime, connue d’elle seule et sur laquelle on se perdra toujours en conjectures.
Le droit de parole
Le 7 novembre 1981, Anjela Duval gagnait les hautes terres pour une moisson d’éternité.
Est-ce donc nécessité, aujourd’hui, de nommer le poète de Traoñ-an-Dour, de le dire, d’en interroger les mots, d’en sentir le souffle de l’esprit en gésine ?
Nous avons certes rompu, à plusieurs reprises, le pain de l’amitié. Mais quelle amitié ? Autre interrogation. Elle fut multiple, donnée en partage à tant d’autres. Anjela enseignait la foule; elle ne concélébrait qu’en intimité.
Ma qualité de journaliste a-t-elle pollué nos relations ? Générant l’événement, Anjela se hissait souventes fois vers les feux de l’actualité et je devenais alors l’interprète privilégié. Nourrissant les colonnes de mon journal de sa célébrité grandissante, le professionnel, trop souvent sans doute, occultait l’ami.
Dans quelle mesure le souci instinctif du (petit ou grand) scoop journalistique n’utilisait-il pas le canal de la sympathie?
Je ne serais nullement surpris qu’Anjela se soit interrogée, sur ce point, à mon endroit. Et sans doute se sentait-elle mieux en phase avec certains dont la sympathie paraissait à ses yeux plus désintéressée. Ce petit cercle, au bout du compte fort réduit, a reçu droit de parole sur Anjela.
Au fil des ans, alors que son aura s’ affermissait dans la souvenance, que s’affinait la pureté de son œuvre littéraire, que s’en dégageait la permanence, de nouveaux disciples ont revendiqué une co-propriété du legs. Ce phénomène s’est particulièrement manifesté lors des cérémonies anniversaires de novembre 1991 au Vieux-Marché.
En soi, cette réappropriation d’une pauvresse, déshabillée par une foule en chasse d’insolite après un demi-siècle de parfait anonymat, celui des humbles de la glèbe, relance un débat. Non seulement le temps ne semble pas oxyder le souvenir de la paysanne, mais au contraire, même au sein de son petit peuple trégorrois, il le dépouille, le purifie, en fixe le rayonnement. Anjela s’enfonce désormais dans les profondeurs de notre histoire communautaire.
Toute réhabilitation présuppose une condamnation. Anjela, poussée dans la mêlée, avait choisi son camp. Et ses adversaires. A-t-elle remporté totalement son combat posthume ? Il est encore trop tôt, à mon sens, pour se prononcer. Une certitude, néanmoins, s’impose : l’appel arthurien qu’a lancé cette femme à ses chevaliers, au nom de son sang, de sa terre, de son identité, de sa culture, cet appel ultime et unique a déjà triomphé du naufrage. Il percute toute conscience qui se veut bretonne.
La fontaine de Traoñ-an-Dour
Le discours actuel sur Anjela Duval, s’il veut tendre au minimum de trahison (à mon avis, nul ne pourra jamais s’accorder à la musique intime d’Anjela), doit explorer plusieurs pistes. Et répondre à une première question : à qui le destine-t-on ? Aux militants du mouvement breton, aux bretonnants cultivés en leur langue ? Ou bien aux générations montantes en besogne d’enracinement, et que la soif d’une culture identitaire conduit toujours vers la « vieille fontaine de Traoñ-an-Dour » » ? Ou bien à ces quêteurs de patrimoine, gens de tous horizons, de toutes races, butinant, pour leur richesse personnelle, dans les fleurs des jardins de poésie ? Ou bien, tout simplement, au peuple de Bretagne, celui qui ne sait pas, mais qui veut savoir, qu’ont un jour touché un mot, une parole, un vers, une image jaillis du bocage, là où se terrait une étrange silhouette de noir vêtue ?
Personnalité plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord, Anjela Duval présente à qui s’intéresse à sa vie, à qui veut étudier son œuvre ou décrypter son message, le visage correspondant à l’angle choisi. Dès lors grande et perverse est la tentation de minorer, d’occulter les autres aspects du personnage.
Au demeurant, Anjela, même de son vivant, a connu cette partition de son être : les uns ne voyaient en elle que la militante du combat breton pour la langue, la culture, d’autres l’écologiste défendant ses talus, ses arbres, et la virginité de sa terre, cependant que certains préféraient repérer en elle l’empreinte du vieux mysticisme celte véhiculant une sagesse ancestrale.
Beaucoup ont célébré son inspiration poétique. Assez peu ont donné la primauté à ses fibres paysannes.
Aujourd’hui, l’écueil demeure : le « poète-paysan » de Traoñ-an-Dour est en péril d’une gloire purement littéraire.
Expliquons-nous. La qualité de son œuvre poétique lui a ouvert les portes du Panthéon de la littérature de langue bretonne. Elle a largement mérité sa place. Auprès des plus grands. Mais cette œuvre est inséparable d’une vie qui, quotidiennement, a toujours réservé la meilleure part de la peine et de la joie à une communion étroite avec la terre nourricière. Inséparable et inexplicable.
Sans nul doute la mise en résonance de ses poèmes peut conduire à la sève qui les nourrit. Encore convient-il d’identifier correctement ce suc vital.
Cette quête ne fournira que des réponses approximatives à quiconque n’a pas eu l’heur de rencontrer, d’interroger, d’observer Anjela Duval dans son cadre, son rythme de vie, son quotidien.
« Mon cœur est un cimetière »
L’étude en chambre d’un poète ne se solde pas forcément par une trahison. Si elle peut être jeu de l’esprit, la poésie se veut par essence chant du cœur. Et ce chant transcende le fait, la situation, l’idée qui l’ont généré. Il tend à l’universalité, devient chant du monde. Et il n’est pas nécessaire d’avoir poussé son pas jusqu’à la demeure en terre battue de Traoñ-an-Dour pour s’accorder à la musique, au message délivrés en certains poèmes. Par exemple ce court poème intitulé « Va c’halon ». Va c’halon zo ur vered / Enni nouspet ha nouspet bez / Enni bembez ur bed nevez / Bezioù kerent ha mignoned… « Mon cœur est un cimetière/ En lui je ne sais combien de tombes / En lui chaque jour une tombe nouvelle / Tombes de parents et d’amis… »
Nous avons tous pleuré un parent, un ami devant une terre fraîchement remuée d’un cimetière et nous pouvons aussi faire nôtre ce lamento.
Mais prenons le poème « An alouberien » qu’Anjela signe, en mars 1964, « Une pauvre patriote, Ur Vrogarourez paour ». La paysanne clame sa révolte devant les envahisseurs qui se sont abattus sur le pays comme une bande de corbeaux. Elle dénonce la vente du patrimoine immobilier et mobilier à des « étrangers », le pillage des chapelles, des manoirs. Anjela laisse percer ici le côté rebelle de sa personnalité. La douce, la sensible Anjela, celle qui n’a jamais pu supporter la vue du sang, même de ses bêtes (elle raconte qu’enfant, elle courait se cacher quand on égorgeait le cochon) a aussi l’âme volcanique. Gare aux coups d’humeur ! Ils sont ravageurs. Cette colère, expression d’un caractère vif (héritage paternel oblige !), ne s’appuie néanmoins jamais sur un fond de méchanceté. Au contraire, elle participe en quelque sorte du sacré. Anjela « dis-joncte » si certaines valeurs, essentielles à ses yeux, sont remises en cause : « Je deviens folle, avait-elle coutume de dire, quand j’entends médire de mon pays (la Bretagne, bien entendu), de ma langue et de mon métier. »
En fustigeant l’accaparement par des non-Bretons (dans le poème, le terme « étranger » demeure vague… en apparence) des pierres, des meubles, du bien transmis par les ancêtres, Anjela impose sa vision de sa « bretonnité ». Le Trégor intérieur, et notamment Le Vieux-Marché, Trégrom, donc l’univers même d’Anjela, a vu s’implanter en d’anciennes demeures restaurées, souvent en bordure du Léguer, des gens de toute nationalité. Anjela en connaissait les anciens propriétaires, elle se souvenait de la vie de ces foyers. Même si certains de ces nouveaux venus la visitaient et lui témoignaient une amitié mêlée d’admiration, la paysanne y voyait usurpation.
Il faut comprendre cette situation locale avant de juger son cri, une sorte d’appel aux armes. La difficulté est là. Anjela s’explique très souvent à partir de son vécu concret. Entre son métier d’agricultrice et l’écriture, il n’y a aucun hiatus. La poésie prolonge, sublime l’acte paysan. N’oublions pas que le poète n’est sorti de sa chrysalide qu’à cinquante ans passés. Déjà, certes, de son enfance à la lisière de la vieillesse, l’alchimie intérieure était en œuvre et nourrissait un chant â qui seul manquait l’outil pour s’extérioriser. Ce devait être la langue bretonne.
Nous venons de citer « An alouberien ». Il serait injuste, mensonger d’y enfermer le message de notre amie. « Stourm a ran war bep tachenn », je résiste sur tous les fronts, fut sa devise. Encore que « An alouberien » pointe vers une approche globale du combat mené par la militante.
Anjela, intelligence extrêmement vive, a pressenti le danger d’une perte identitaire irréversible. Or, tout en elle respirait l’identité. Son enracinement dans son héritage terrien, son mode de vie enseigné à domicile et présenté comme la somme d’une sagesse, d’une connaissance multiséculaires, la découverte de sa « bretonnité » par la langue, la culture, l’histoire.
Elle a capté les ondes du séisme installant un monde nouveau. Or, ce monde lui est surtout apparu destructeur. On rase les talus, on abat les arbres centenaires. La chimie tue le processus biologique naturel dans le ventre de la terre. L’exode pompe la jeunesse, la télévision nivelle, façonne l’opinion. Anjela ne voyait pas de passerelles possibles entre le monde ancien, le sien, et celui qui s’annonçait.
D’où ce que d’aucuns jugeront aujourd’hui comme un refus d’évolution, comme une attitude rétrograde, comme un repli farouche et chouan sur une époque révolue.
Mais peut-on parler d’évolution ? Ne s’agirait-il pas plutôt de révolution ? Anjela, par tempérament, par éducation, n’était nullement préparée à une tâche de transition. Et elle le savait. Anjela a certainement vécu un drame intérieur. La Bretagne du possible, celle qu’elle célébrait dans ses vers, n’était plus déjà que celle de l’impossible. Anjela vivait une utopie lucide.
Femme du sacré, comment aurait-elle pu s’accommoder d’une désacralisation en marche ? Elle tenait en ses mains calleuses le flambeau ancestral. Et sur la fin de ses jours, silhouette d’autre-monde, elle tendait le bras. Pour la transmission du legs. « Torfed eo terriñ ar chadenn », crime que la chaîne brisée.
Nul, il est vrai, ne l’a poussée en première ligne du combat breton. Sans doute, sa découverte tardive de la langue, de la culture, elle la doit à des personnalités dont les convictions impliquaient une adhésion à la cause bretonne : Ivona Martin, Roparz Hemon, les abbés Guillaume Dubourg, Marsel Klerg… Mais rien n’obligeait Anjela à chanter autre chose que sa terre, ses bêtes, la noblesse de son métier, les mille et une petites choses meublant ses journées besogneuses. Et une partie, peut-être la plus grande de son œuvre, joue sur le registre bucolique, rejoignant par là Loeiz Herrieu, le barde-laboureur. Dans ces moments de confidence, chevalier sans armure, sa musique intimiste est au plus près de sa justesse. L’inspiration devient sève. Les vers, les mots qui germent sur la page du cahier, alors que le feu danse sa joie dans l’âtre ont le goût, le parfum des plantes dites « sauvages », celles qui recouvrent ses talus.
Le dernier barde-laboureur
Anjela, par son authenticité terrienne, a enrichi la littérature de langue bretonne de pages uniques, nécessaires. Au sein de l’élite bretonnante, personne d’autre n’avait qualité, ni possibilité, de dire en de telles fulgurances, la simple beauté d’un champ de blé, la symphonie des matins, le rythme d’une journée de battage.
J’en ai bien peur : ma vieille amie, la grande dame de Traoñ-an-Dour, aura été le vrai dernier barde-laboureur. Et, reprenant sa psalmodie, force nous sera de revenir à cette ultime source, pour nous réaccorder au chant profond de la terre. On opposera que bien des poètes se situent dans ce registre. À la différence d’Anjela, sans que la qualité de leurs œuvres soit en cause, ils voient, ils sentent la nature du dehors. La fermière vieux-marchoise, en osmose permanente avec la glèbe, exprime le dialogue qu’elle entretient avec elle, d’un angélus à l’autre.
Me voici confronté à une interrogation majeure. Anjela aura-t-elle été un météorite dans le ciel de notre littérature ou demeure-t-elle une étoile scintillant toujours dans notre firmament ?
Une décennie suffit largement à recouvrir du voile d’un oubli définitif bien des auteurs. Or, Anjela Duval figure désormais dans le Panthéon des poètes de langue bretonne. Son œuvre, ses recueils de poèmes édités, font partie des classiques.
Mais, personnalité composite, Anjela véhicule toujours une sorte d’aura. La masse, celle qui ne la lit pas, se souvient d’elle comme d’une personne hors du commun, paradoxe vivant. C’est vrai. En ses quelque vingt années de vie « publique », Anjela a frappé ses compatriotes, les gens qui l’approchaient ou seulement la voyaient et l’entendaient à la radio ou à la télévision. Une pauvre femme ridée, cassée par le labeur, paysanne de surcroît, vivant « à l’ancienne », se dressait, fière, rebelle, et le verbe aussi haut que châtié (Anjela s’exprimait à l’occasion dans une langue française qui, je l’avoue, m’a parfois contraint de re-courir au dictionnaire !), disait son fait à tous les faiseurs de monde aussi bien qu’au peuple coupable à ses yeux de trop de renoncements.
Les médias adorent les atypiques. Anjela en était. Elle a été jetée en pâture {et sur ce point je porte ma part de responsabilité) à la curiosité de la foule. Heureusement, la curiosité est éphémère. Et ce n’est pas par ce côté « voyeurisme » que s’est maintenu dans l’opinion bretonne actuelle le sentiment d’une femme exceptionnelle, porteuse d’une grande sagesse, de valeurs qui cimentèrent la société bretonne, dont l’intelligence rayonnait, dont la force d’enracinement interpellait. Le nom d’Anjela Duval fleurit sur les plaques au coin des rues, des places. Je n’entends nullement condamner cette réhabilitation posthume. Anjela Duval a honoré et honore toujours la Bretagne. Hommage lui est dû.
Mais que vaudra cet hommage dans quelque temps ? Les souvenirs s’oxydent encore plus vite que les plaques.
Je pense que la permanence du poète de Traoñ-an-Dour circulera grâce à ses textes, surtout poétiques. Le message s’y trouve. Divers, contrasté. Poèmes-prières de la chrétienne, poèmes-célébrations du rite paysan, poèmes-méditations sur la souvenance des êtres chers, poèmes-cris de la Bretonne en lutte pour sa langue, sa culture. À chacun sa manne. Mais ne disséquons pas le message. Il n’y a pas d’un côté l’Anjela qui dit la peine des gens de la terre, de l’autre l’Anjela militante, mystique.
Anjela Duval n’appartient à personne. Nul n’a sur son legs droit de propriéte. Elle appartient à la Bretagne.
Et notre devoir, le seul que peut-être elle attend de nous, est de ne pas laisser, plus que son souvenir, son chant en jachère. Ses poèmes doivent être diffusés, répandus au maximum. Si une traduction française s’avère utile et conduit le lecteur vers le texte original en breton, qu’on le fasse. La demande existe. Un public de plus en plus large, et dont la démarche paraît honnête, voudrait accéder aux trésors de la poésie d’Anjela. Mais il n’a pas la clef d’or qui ouvre le coffre : celui de la langue bretonne.
Tous les grands poètes du monde font l’objet de traductions. L’universalité de l’œuvre d’Anjela plaide pour cette internationalisation, bien que seul le breton garde à son œuvre la dimension de son génie.
Paru dans ArMen n° 56, janvier 1994, pp. 18-27. Traduction en breton par Corinne ar Mero pour l’édition de l’Œuvre complète (Oberenn glok), texte accessible ici.